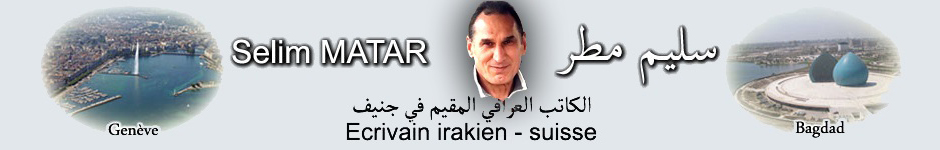Journal Le Temps /GENEVE
Jeudi 19 février 2004
Après vingt-cinq ans d'exil, Selim Matar est retourné à Bagdad, un voyage au goût amer
L'écrivain Selim Matar devait rester trois semaines dans sa ville natale, il a présumé de ses forces
Rubrique: Société
«Bagdad... Inconsciemment je m'attendais, en y arrivant, à une continuité. Un peu comme si j'avais mis sur pause une cassette vidéo en partant et que je la remettais en route en rentrant. Mais en vingt-cinq ans, non seulement le film s'est terminé, mais plusieurs autres ont passé. Les enfants d'alors sont devenus les parents d'aujourd'hui, les mentalités ont changé, ma vision aussi. C'est logique mais ça a été un immense choc.»
Selim Matar, écrivain irakien très connu dans son pays, a retrouvé la capitale le 20 décembre, après trois jours d'un épuisant voyage. En avion d'abord, jusqu'à Amman, puis à travers la Jordanie dans un bus de location. Première surprise le passage de la frontière irakienne se fait sans aucun contrôle. Puis c'est la traversée du pays dans sa largeur, le passage de l'Euphrate et enfin du Tigre.
«J'ai découvert des paysages inconnus de l'enfant de la ville que je suis, j'essayais de reconnaître les images vues à la télévision. En ville c'était différent. J'ai d'abord été fier de voir la taille de Bagdad, le fleuve, les palmiers. J'ai senti sa grandeur mais aussi ses blessures, les bâtiments, détruits, brûlés, d'autres étrangement épargnés.»
C'est l'heure de l'épreuve de la réalité pour l'écrivain et de la rencontre avec un peuple «humilié et anesthésié».
Si bien qu'on y a encouragé la délinquance, les intellectuels se faisaient tabasser, et ces lieux ont été désertés.»
Rien à voir donc avec les salles obscures de son adolescence. «Souvent, je m'enfuyais du café de mon père – où je travaillais après l'école de 6 à 15 ans – sous prétexte d'une course. J'allais voir un film, quitte à être battu au retour. Car mon père pouvait être très brutal, mais aussi me consoler en me chantant des chansons. Il était plein de contradictions. C'était un grand conteur, il ne se gênait pas pour mimer des scènes osées devant les clients, raconter ses aventures.» Le café était situé à côté des services secrets. «J'apportais les boissons et les sandwichs aux prisonniers. J'ai assisté à des interrogatoires et même à des scènes de tortures. Tout ça m'a influencé dans mes choix politiques.»
Le château de cartes
Juste à côté du café, séparé par un terrain vague, il y avait une merveilleuse maison. «C'était le château de mes songes. J'étais amoureux de la jeune fille qui y habitait. C'est devenu une jungle. Les lieux ont abrité les services secrets de Saddam, tout s'est dégradé. La famille a sombré dans la pauvreté, mon amour était parti. J'ai pleuré devant l'anéantissement de mes rêves.»
Le quartier du centre-ville où Selim est né lui est resté inaccessible. «C'est devenu une partie du palais de Saddam. Maintenant c'est Paul Bremer, l'administrateur civil américain, qui s'y trouve, mais je n'ai pu approcher. Par contre, la vue du pont de la République, qui relie les deux parties de Bagdad coupées par le Tigre, m'a fait revenir d'un coup à l'époque où je le traversais avec mon père pour aller au café, au lever du jour dans un petit matin glacé.»
La plongée dans la réalité des Bagdadis n'a pas été moins douloureuse que la confrontation avec la ville. Selim découvre «un peuple malade et blessé». «Les gens sont résignés après ces années de guerre. Ils ne croient plus à rien, ils sont calmes, et ne s'engagent pas politiquement. Rien à voir avec l'agitation qu'on montre à la télévision. Et le retour à la religion des Irakiens me semble procéder surtout d'un désir de tranquillité. L'attitude générale est plutôt ouverte, loin du fondamentalisme. J'ai été étonné de voir des images de la Vierge Marie dans des intérieurs musulmans. Les gens fêtent le 31.»
En fait, c'est le silence qui a frappé Selim pendant son séjour. L'absence totale de musique, de manifestations culturelles et tout simplement de discussions. «Les Irakiens sont de nature ardente, ils sont extrêmement curieux, adorent les débats, aiment danser, chanter. Là, je les ai trouvés complètement à plat, provisoirement j'espère.»
Une journée pour un plein d'essence
C'est que les tracas du quotidien les absorbent totalement. Il faut une journée pour faire un plein d'essence, hors de prix. Seuls 10% des foyers ont le téléphone, toutes les démarches sont donc compliquées par la difficulté des communications, et chacun reste chez soi.
«Mes relations avec ma famille sont également restées superficielles. Ils étaient très chaleureux, mais ne m'ont posé aucune question. Je me suis senti étranger, à tel point que, lorsque j'ai croisé sur l'autoroute une voiture à plaques genevoises, j'étais tout content. Cela m'a réchauffé le cœur!»
Selim admet toutefois qu'il s'est toujours senti différent. «Je suis né étranger. Nous étions des musulmans chiites pauvres, d'origine paysanne, émigrés du sud. Nous habitions dans un quartier riche, peuplé en majorité de chrétiens irakiens. Les gens se moquaient de nous, de notre accent, de nos habits. Je me suis révolté à 14 ans et je suis devenu athée puis communiste. Comme baassistes, mes frères devaient dénoncer et espionner leurs proches, cela a été un grand facteur de tension familiale. J'avais toujours peur qu'ils aient des ennuis à cause de moi.»
Selim Matar quitte donc l'Irak en 1978, passe quelque temps au Liban, pour préparer la libération de son pays avec les guerriers de l'opposition, et comprend vite qu'il est instrumentalisé. «Il y avait au Liban tous les services secrets du monde. Ils se servaient de nous comme de pions sur un échiquier en s'abritant derrière des slogans révolutionnaires. Nous étions des marionnettes. Alors, j'ai choisi de servir mon pays à travers la culture et de partir en Europe pour développer mes connaissances. C'est pourquoi il m'a été tellement douloureux de constater le vide culturel que connaît mon pays actuellement.»
Depuis la Suisse, dont il a acquis la nationalité après son mariage, Selim n'a cessé d'écrire, des nouvelles, des romans, des essais, des articles pour tous les grands journaux arabes édités à Londres, comme Al Quds ou Al Hayat. C'est un essai, L'identité blessée, qui l'a rendu célèbre dans son pays. Il est actuellement au programme de deux universités de Bagdad.
Identité déchirée
«Je suis à l'origine d'un courant de pensée qui revendique une identité irakienne composée d'une mosaïque de communautés vivant en bonne intelligence, un peu comme la Suisse. Ce livre était interdit en Irak, mais il s'est vendu sous le manteau, les gens l'ont photocopié, et j'en ai trouvé un exemplaire au marché de Bagdad.»
Après deux semaines d'un séjour qui devait en durer trois, Selim est tombé malade, une grippe qui lui a coupé et la voix et le souffle. «C'était trop, j'ai dû rentrer à Versoix», convient-il.
«Je crois que je suis condamné à ce déchirement de mon identité entre l'Irak et la Suisse. C'est une souffrance que je porterai toujours, mais je suis revenu de ce voyage avec une vision plus réaliste. Avant, l'Irak était pour moi un fantasme. Maintenant, il fait partie d'un passé stabilisé. Toutefois, mon engagement intellectuel et moral reste. Et je suis en train d'essayer de créer, avec j'espère le soutien de la Suisse, un centre d'études irakien à Bagdad qui publiera une revue sur l'identité irakienne et que je dirigerai d'ici.»